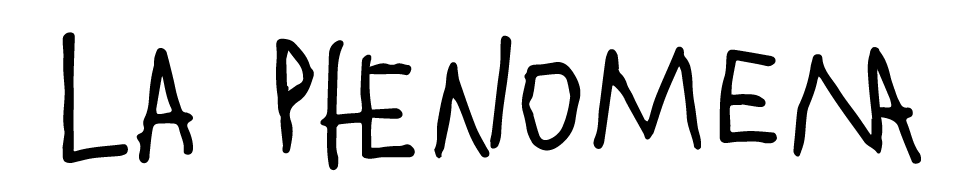LES NOCES DE FIGARO
(Variations)
En tant que compositeur, tu as participé aux discussions préparatoires au projet Les Noces, variations. Cherchant un opéra qui pourrait être interprété par un chœur d’enfants, comment votre choix s’est-il arrêté sur Les Noces de Figaro ?
Arthur Lavandier : La saison passée, j’avais travaillé sur La Légende du Roi Dragon pour lequel j’avais signé le livret et la partition. Cette fois, la directrice de l’Opéra de Lille, Caroline Sonrier, souhaitait imaginer un opéra du répertoire qui pourrait être chanté par des enfants. Nous avons réfléchi à différentes possibilités, dont Der Freischütz ou un opéra de Wagner – j’aimais l’idée d’un format court avec une ambiance Heroic Fantasy… Au fur et à mesure de nos discussions, nous nous sommes finalement fixés sur Mozart. Nous avons hésité entre La Flûte enchantée et Les Noces de Figaro. Le premier avait pour lui la magie, le second mettait en œuvre une critique sociale qui se révélait passionnante. Nous avons choisi “Les Noces”. C’est une partition incroyable, un véritable enchaînement de tubes. Même les récitatifs sont connus. Nous savions donc qu’en en extrayant une version courte, elle contiendrait forcément quelques-uns des airs d’anthologie de Mozart.
Contrairement à La Légende du Roi Dragon, l’œuvre existait déjà. Comment ton travail s’est-il organisé ?
Arthur Lavandier : La première question était de savoir si nous ferions ou pas un arrangement musical. Le cahier des charges impliquait un spectacle court d’environ une heure, alors que l’œuvre originale dure 3 heures 40. Le nombre des personnages était également limité à cinq. Finalement, nous avons décidé de ne pas faire de réduction mais de travailler dans la fosse avec l’Orchestre de Picardie. Je pense que l’une des raisons principales à ce choix était la présence des trois-cents enfants sur scène et dans la salle : il fallait avoir un contrepoids musical suffisamment puissant pour supporter ce grand nombre. A partir du moment où j’ai su que je ne ferais pas d’arrangement, mon rapport à la partition originale a été tout autre. Lorsque je compose un arrangement, il m’arrive d’avoir une forme de distance à la musique. Là, j’ai dû m’imprégner complètement de la musique. J’emploie à dessein le mot “musique” plutôt que “partition” car j’ai privilégié l’impression sur le regard technique ou analytique. Je l’ai beaucoup écoutée sans regarder la partition, avant d’en venir à la phase plus technique.
Je me souviens effectivement qu’au début de nos discussions, tu as souhaité oublier les réflexes intellectuels au profit d’une approche plus intuitive, plus ludique de l’œuvre originale. Tu parlais de flashs…
Arthur Lavandier : J’ai eu besoin de me reposer en auditeur de la musique de Mozart. Quand on touche à une œuvre qui n’est pas la nôtre, on peut planifier très précisément la façon dont on va la déconstruire. On peut aussi adopter une approche plus instinctive que je trouve personnellement plus libératrice. Au début de nos discussions, j’avais employé le mot flash qu’utilise le philosophe Walter Benjamin à propos de la pensée : il dit que lorsqu’un flash survient, il ne faut pas hésiter à le suivre.
Lorsque nous avons discuté en échangeant des références, tu nous as parlé du troisième mouvement de la Sinfonia de Berio qui était pour toi une œuvre de référence particulièrement inspirante dans sa structure. Est-ce la fréquentation de certains compositeurs contemporains qui t’a appris à redécouvrir les œuvres avec un regard plus naïf ?
Arthur Lavandier : Je pense que c’est surtout la conviction qu’on a le “droit” de faire ce qu’on veut avec les oeuvres du passé, avec la musique qui existe déjà, la certitude qu’on peut réutiliser un matériau pour lui donner une nouvelle vie, l’orienter dans une nouvelle direction, jeter sur lui une lumière nouvelle… Pour moi, ça a toujours été une évidence, mais j’ai souvent croisé des gens qui n’étaient pas de cet avis. Cette conviction est chez moi renforcée par mon parcours : j’ai beaucoup étudié “l’écriture musicale”, j’ai appris à pasticher Mozart, Ravel ou même Stockhausen… J’ai commencé à écrire “à la manière de” à l’âge de 13 ans et, par la suite, cette pratique a forcément influencé mon rapport à la musique.
Dans le spectacle, tu joues à dérégler la musique de Mozart, à la faire bugger comme si l’on n’était pas en train d’écouter un orchestre mais un disque rayé…
Arthur Lavandier : Oui, ce travail sur le disque – ou sur les supports de diffusion en général, qui font partie intégrante de l’Histoire de la musique – sur la matérialité du son, m’inspire beaucoup. Quand on est dans un concert, l’aspect concret des musiciens en train de jouer peut disparaître si l’on s’abandonne totalement. La réalité tangible s’efface alors au profit de la réception pure, et les deux niveaux peuvent alors coexister. J’aime jongler entre les deux. C’est encore plus jouissif dans le cas d’un opéra qui est censé raconter une histoire. Et puis, quand je travaille sur une œuvre de Mozart, le médium technologique que j’utilise est déterminé historiquement : c’est la partition.
La musique des Noces, variations est également habitée – ou en tout cas traversée – par d’autres opéras…
Arthur Lavandier : Oui, notamment par Don Giovanni, qui montre brièvement le bout de son nez. J’aime la théorie qui dit qu’en grandissant, Cherubino deviendra Don Giovanni… Il s’agit davantage d’une licence que d’une forme de désobéissance. On ne s’en rend pas forcément compte. J’utilise souvent ce procédé dans ma musique. J’aime les surimpressions, les images fantômes, quand l’auditeur croit avoir entendu quelque chose sans en être tout à fait certain…
Propos recueillis par Simon Hatab