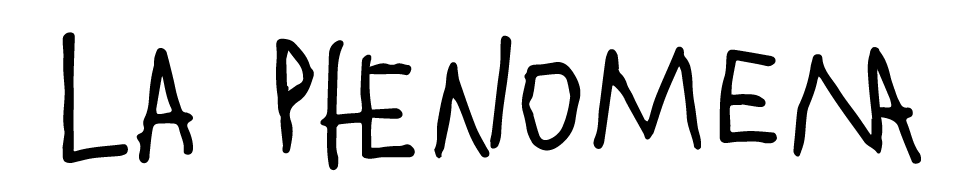À première vue, le texte de Frédéric Vossier, Pupilla, semble se consacrer stricto sensu à la personne de Liz Taylor. Pourtant, le personnage mis en scène est traversé par une multitude de figures. De quelle manière Laure Werckmann parvient-elle à incarner cette multiplicité ?
Maëlle Dequiedt : Il me semble que le projet de Frédéric Vossier, à travers ce texte, va à l’encontre de ce que pourrait être un biopic, soit la tentation de résumer une vie et donc de l’enfermer dans un récit. Il joue à déconstruire le cliché de cette actrice hollywoodienne pour aller au-delà. Il tente de capter le secret d’une force vitale à travers la figure de Liz Taylor. Partant de la surface du cliché, le texte propose une plongée intérieure, comme si on zoomait, qu’on cherchait à voir au microscope ce qui faisait l’essence de cette pulsion de vie, de cette personnalité exposée à tous les regards, pour en livrer une vision singulière. Pour cela, l’auteur invente une langue poétique et radicale, la plus apte à rendre compte de la liberté, de la démesure, du désir absolu de dévorer la vie, de casser les normes et les cadres. Et ce portrait imaginaire est porté par une seule voix, celle d’une comédienne, Laure Werckmann. Il s’agit donc d’une comédienne parlant d’une comédienne. Laure aborde le début du spectacle en tant que « spectatrice-narratrice », évoquant la vie de cette icône de cinéma. Elle déambule dans un espace qui peut s’apparenter au départ à une salle de cinéma abstraite, intemporelle. C’est une femme seule circulant au milieu de rangs de chaises vides. Cette situation simple va petit à petit se dérégler, l’espace concret va se faire plus mental, l’écran de cinéma se révéler être une toile de projection pour son inconscient. Nous ne cherchons à aucun moment à incarner Liz Taylor. Nous restons dans une zone intermédiaire, en jouant du trouble d’une actrice évoquant une autre actrice. Dans cette solitude, seule en scène, l’actrice va dériver, s’inventer une propre fiction, incarner tous les personnages à la fois. Le glissement est incessant dans la parole. On ne sait plus qui parle souvent, et la confusion s’opère entre le sujet et l’objet, la narratrice et l’actrice.
Le mot « pupille » renvoie au champ de la vision, de même que le suffixe « -la » fait référence à l’enfant, c’est-à-dire étymologiquement à « celui qui n’a pas accès à la parole ». Ce faisant, le titre pose la question du regard et de la voix.
Maëlle Dequiedt : On dirait qu’elle est traversée par un concert de voix et de fantômes. Le début du texte joue avec des anecdotes que pourraient rapporter les médias. Et déjà, on perçoit que plusieurs biographies se superposent, celles d’autres femmes qui, comme Liz Taylor, ont eu une existence hors de la norme et subversive. Des femmes qui, en revendiquant une féminité exacerbée, ont mêlé dans leurs vies art, sexualité et politique. Sans jamais être nommées directement, d’autres biographies apparaissent en superposition à celle de Liz Taylor : La Cicciolina, actrice pornographique, chanteuse et politicienne italienne ou encore Christine Keeler, call-girl à l’origine d’un scandale d’état dans l’Angleterre des années 60. D’autres personnages apparaissent comme Ludwig et Richard. Ces derniers peuvent eux-mêmes faire référence à des personnages historiques et de fiction. Ludwig est le nom du fils de la Cicciolina et de Jeff Koons qui, à peine né, s’est retrouvé au cœur d’une bataille judiciaire et médiatique. Mais Ludwig, c’est aussi Louis II de Bavière, empereur mécène de Richard Wagner et cousin d’Elizabeth d’Autriche, qui a donné son nom au film de Visconti : Ludwig ou le crépuscule des dieux. Richard, c’est peut-être Richard Burton (marié deux fois à Elizabeth Taylor, ou Richard Wagner). On navigue ainsi entre ces différents niveaux de réalité et de fiction, comme dans un rêve qui procéderait par association d’idées. Ce mélange sème ainsi le trouble et nous invite à sentir que le sujet réel de la pièce dépasse la personne même de cette actrice pour parvenir à un niveau de questionnement existentiel.
L’action se déroule sur un plateau nu, dépouillé, cependant que le texte de F. Vossier apparaît comme foisonnant et protéiforme. Dans quelle intention vous êtes-vous astreinte à ne pas utiliser de décor ?
Maëlle Dequiedt : Il s’agit de trouver l’espace qui permette au texte de se déployer, en faisant surgir l’énergie dans le corps de l’actrice notamment. Notre dispositif scénique est volontairement simple et propose à Laure des éléments qui pourront lui servir d’appuis physiques. Beaucoup d’images sont déjà présentes dans le texte, nous cherchons ainsi à conserver un terrain de jeu ouvert qui ne fige pas la représentation. Nous sommes donc prudents dans l’utilisation d’images projetées qui enfermeraient le spectateur dans un imaginaire trop restreint. Pupilla est un texte surprenant dans son développement. On croit savoir de quoi l’on parle au départ et l’on est dérouté au fur et à mesure. Le texte de Frédéric Vossier procède par dérives successives et mêle le réel à la fiction. À partir d’un moment, Elizabeth ne fait plus seulement référence à l’icône Elizabeth Taylor mais devient un être de fiction à part entière. Plusieurs strates se superposent. Au plateau, nous cherchons donc à trouver comment Laure circule entre ces différentes identités, ces différents univers. C’est l’actrice qui par la parole construit cette fiction. Dans la scénographie, conçue avec Solène Fourt, nous partons d’une salle de cinéma pour passer par la chambre d’un château en Allemagne et finir au sommet d’une haute montagne. Comme dans mes autres spectacles j’aime travailler avec peu d’objets au plateau (des chaises, un rideau de fils, un manteau de fourrure, quelques bouteilles, des cigarettes), un dispositif simple qui évolue et que l’on épuise.
La musique, tout comme la vidéo, tiennent une place importante dans votre spectacle. Comment ces deux médiums vont-ils se mêler, se superposer au corps de la comédienne ?
Maëlle Dequiedt : Ce qui m’intéresse ici, c’est de trouver une correspondance au projet de Frédéric Vossier dans l’écriture, à savoir parler de l’actrice Elizabeth Taylor en empruntant le langage du sublime. Ce frottement du kitsch et du sublime notamment m’intéresse en musique. Nous étudions comment une chanson populaire italienne peut côtoyer un extrait de l’opéra Tristan et Isolde de Wagner par exemple. La vidéo est également là pour proposer une ouverture, un dialogue avec le corps de la comédienne au plateau. Il devient l’espace fantasmatique d’une possible rencontre entre l’image de l’icône et l’image de l’actrice au plateau, comme si la frontière entre le plateau et l’écran, le cinéma et la vie, s’effaçait.
Propos recueillis par Aurélien Péroumal, décembre 2018.