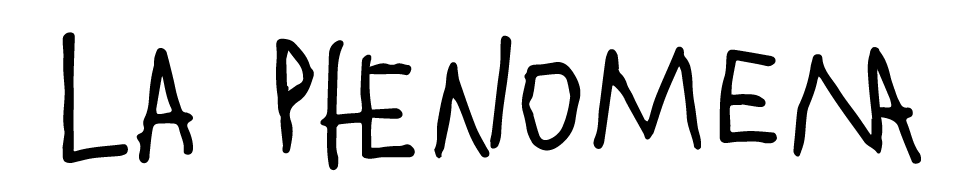Dans le cadre de ce numéro qui revient sur l’œuvre de Richter, un des auteurs dramatiques et metteurs en scène marquants de la scène théâtrale européenne actuelle, il m’a paru important de savoir ce que sa vision du monde et son écriture avaient à dire à une génération entrée sur la scène artistique mais aussi sur la scène sociale plus récemment. Je voudrais donc d’abord vous interroger sur l’expression qui figure dans le sous-titre de votre spectacle : «d’après Falk Richter». Elle suggère à la fois que, dans votre création Trust −Karaoké panoramique, vous avez livré votre interprétation de l’œuvre de Richter, et que vous avez créé après cette œuvre… et après cet artiste. De fait, votre spectacle est à l’origine une commande de Stanislas Nordey qui, en 2015, a demandé à quatre élèves metteurs en scène de donner chacun leur vision, leur version de Trust. Dans l’entretien croisé qui figurait dans la feuille de salle lors de la création, vous indiquiez justement que l’exercice vous avait paru tout à la fois difficile et pertinent du fait d’une gêne initiale face au texte, à la fois parce que vous ne vous sentiez «pas fondamentalement en accord avec le propos» et parce que «la génération qui s’y exprime n’est pas la (v)ôtre». J’aimerais que l’on revienne d’abord sur ce double décalage.
Maëlle Dequiedt : Il était difficile pour moi et pour mon équipe de nous saisir de ce texte pour plusieurs raisons. D’abord, parce qu’il s’agit d’une écriture de plateau : Falk Richter a écrit ce texte à partir d’improvisations réalisées en répétition par ses interprètes. Or, je n’avais pas accès au spectacle tel qu’il l’a mis en scène, et je sentais qu’à la lecture il me manquait des clés : je pense notamment à la logique d’assemblage des fragments. Monter le texte tel quel m’aurait semblé un contresens : il m’est apparu évident qu’il fallait retraverser et recréer l’œuvre. Quant à se reconnaître dans le texte, la question n’est peut-être pas tant «générationnelle » : les personnages que décrit Falk Richter appartiennent aux élites financières. Ils passent leur vie à attendre dans les aéroports, à arpenter les terrains de golf ou à observer le monde derrière la vitre du 27e étage d’un immense gratte-ciel. Ils sont déconnectés du réel et, par là, loin de nous. Or, dans mon travail, le lien entre la fiction et le réel est fondamental. C’est la raison pour laquelle, au plateau, je n’aime pas la notion de «personnage » mais préfère celle de « figure », qui suggère une construction à la frontière du personnage et du comédien. Nous ne nous retrouvions pas dans ces histoires. Nous n’arrivions pas à trouver des points d’aspérité pour entrer dans le texte.
Était-ce vous qui ne vous reconnaissiez pas dans les personnages et/ou était-ce le monde représenté que vous ne reconnaissiez pas comme étant le vôtre ?
Maëlle Dequiedt : Les deux, je pense. Entre l’écriture de la pièce en 2009 et le moment où nous l’avons montée en 2015, le discours sur la crise avait évolué. Il y avait nécessité d’une réactualisation du texte.
De fait, Trust parle de la crise financière de 2008 depuis ce moment et depuis cette crise, il s’agit d’un point de vue à chaud et du dedans de l’événement, tandis que vous revenez à ce texte presque dix ans après. Le décalage temporel est là aussi : vous assumez un regard rétrospectif qui regarde ce passé avec distance, depuis un présent saturé par de nouveaux événements politiques qui marquent tout autant de violentes ruptures. Pourtant, vous convoquez dans votre spectacle deux événements récents, d’une façon qui revitalise le texte parce qu’elle l’inscrit dans une séquence plus large, et toujours d’actualité : la crise de la dette en Grèce prolonge et cristallise à l’échelle d’un pays et d’un État la crise financière mondiale de 2008, et les attentats de Paris et Saint-Denis résonnent comme un écho sinistre et très rapproché du 11-Septembre.
Maëlle Dequiedt : En réalité, la réactualisation s’est faite en deux temps : en 2015, lorsque nous avons créé Trust − Karaoké panoramique au Théâtre National de Strasbourg, puis en 2017, lorsqu’il a été repris et remanié au Théâtre de la Cité internationale. Il nous a semblé évident que si on ne le frottait pas à notre présent, ce texte n’avait aucun intérêt. Nous avons donc été attentifs à l’actualité durant tout le temps de la création pour l’incorporer au spectacle. Nous utilisions par exemple les journaux du jour en répétition. L’un des acteurs − Romain − s’en servait en jeu pour construire son parcours au sein du spectacle.
Quels sont les changements les plus importants ? L’élargissement de la façon de décrire la crise : alors qu’en 2008, on parlait d’un effondrement financier, en 2015, il était davantage perçu comme social et politique. Les attentats ont eu lieu pendant notre période de création. En répétition, nous travaillions par associations d’idées, afin de rester poreux à tout ce qui nous entourait. Cette violence a donc rejailli dans les improvisations.
Maëlle Dequiedt : Par ailleurs, entre la création de 2015 et la reprise en 2017, le monde avait continué de changer : nous avions traversé les mouvements sociaux d’opposition à la loi Travail, l’élection de Trump, puis celle de Macron… Le spectacle a évolué en se nourrissant de ce « présent ». Nous avons par exemple supprimé la référence à la crise grecque de l’été 2015. Nous cherchions également à comprendre comment le discours politique cherche à « réassurer », à donner confiance à ses auditeurs. À la création, c’était à travers un discours de François Hollande. À la reprise, c’est naturellement devenu un discours d’Emmanuel Macron. Bien sûr, il ne s’agit pas de transformer le spectacle en journal de 20 heures et ce n’est pas uniquement pour redonner au texte de Richter une actualité qui se serait émoussée : j’ai besoin de ce «présent », de vie, d’improvisation : c’est ce qui permet au spectacle de rester vivant, en tension, en mouvement.
En tant que telle, la question du néolibéralisme reste d’actualité, non seulement parce qu’il n’a pas diminué son empreinte sur nos sociétés, mais aussi parce qu’il pose un problème spécifique en ce qu’il s’est immiscé dans tous les aspects de nos vies, a envahi nos langages, nos rêves, a incorporé nombre des critiques qui lui étaient adressées et a su se rendre très séduisant et désirable. Vous sentez-vous concernée par cette question en tant que personne ou estimez-vous qu’elle vous concerne aussi en tant qu’artiste travaillant dans le théâtre subventionné ?
Maëlle Dequiedt : Oui, bien sûr, elle me concerne aussi en tant qu’artiste, c’est toute la difficulté de l’engagement, qui implique de se positionner contre un système auquel nous appartenons et, à des degrés divers, participons. La logique néolibérale n’épargne pas le théâtre subventionné, hanté par les mots «marché », « concurrence », « rentabilité », par la nécessité de vendre ses spectacles. C’est d’ailleurs l’une des choses que nous abordions dans le spectacle − la position de l’acteur dans la société : lorsque Maud, qui ne sait pas quoi faire de son argent, propose de subventionner Pauline à condition qu’elle anime ses réceptions privées.
Avez-vous malgré tout l’impression qu’il existe des marges de manœuvre, un horizon?
Maëlle Dequiedt : Oui, je pense que la crise à laquelle nous sommes confrontés dans le monde de la culture nous force à imaginer d’autres moyens de production, notamment par la mutualisation et le travail en collectifs. Nous travaillons par exemple avec un bureau de production − Prémisses, dirigé par Claire Dupont − qui cherche à inventer un nouveau modèle dans le champ de l’économie sociale et solidaire. À travers cette réflexion sur les moyens de production, c’est notre manière de créer que nous repensons.
C’est ce qui explique aussi la différence entre le discours que vous tenez dans le spectacle et celui de Richter dans Trust ? Vous évoquez un certain pessimisme dans son œuvre.
Maëlle Dequiedt : J’ignore si Richter a connu un âge d’or qui se serait effondré. Peut-être est-ce ce qui explique ce pessimisme que je ressens en effet dans son œuvre. Pour ma part, j’ai l’impression que notre génération entend parler de cet effondrement depuis toujours, ce qui nous permet au moins de faire l’économie du passéisme. Pour moi, l’une des fonctions du théâtre est de déployer sur scène un imaginaire qui communique un désir d’autre chose. Comme le dit Pessoa dans les Poèmes païens : « L’espoir est un devoir du sentiment. » Je pense qu’il est important de présenter sur scène des gens qui se battent − même s’ils échouent −, de convoquer sur le plateau une série d’engagements − même s’ils semblent dérisoires.
Le néolibéralisme pose aussi une question esthétique : Richter travaille l’appauvrissement du langage et des psychés des jeunes cadres dynamiques névrosés, cela pose la question de la stratégie mimétique de l’écriture. Est-ce une écriture entre résignation et résistance, ou résistante malgré une impression première de résignation voire d’acceptation ambivalente du système ?
Maëlle Dequiedt : Oui, le mot « résistance » est convoqué dans Trust, mais cette convocation est ponctuelle, exceptionnelle, elle prend la forme d’une question − « la résistance est-elle possible ? » − comme une hypothèse à laquelle la génération de Falk Richter n’ose peut-être plus croire. Quant à la question du mimétisme à l’œuvre dans le texte, notre spectacle ne se limite pas au texte de Richter. Il accueille d’autres langages : des fragments de Tchekhov ou de Henry Miller, les performances poétiques de la figure de Pauline, quelques mesures d’une sonate de Schubert, jusqu’aux scènes d’improvisation où la représentation disjoncte, devient hors de contrôle. Cette fusion des langages nous permet de rechercher une forme de contrepoint et, d’une certaine façon, de résister à l’appauvrissement du langage et des psychés que vous évoquez.
De fait, le spectacle est construit autour du parcours individuel de chaque acteur-personnage. Pouvez-vous revenir sur la façon dont cette structure s’est élaborée durant le processus de création ?
Maëlle Dequiedt : Je me suis réellement approprié le texte à partir du moment où j’ai cherché à identifier six figures distinctes correspondant aux six acteurs, qui seraient chacun convoqués sur un territoire différent. Sur le papier, les personnages de Falk Richter sont très stéréotypés : femme d’affaires en quête de relations durables, trader-activiste qui projette de faire sauter la Bourse, millionnaire dépressif qui hante les terrains de golf et les soirées karaoké pour retraités, chercheur-universitaire en burn-out écrivant un livre sur le thème «VIVRE SOUS LA CRISE»… Partant de là, j’ai cherché à créer des figures assez complexes. Je voulais leur ajouter une épaisseur, une part d’humanité. J’ai passé commande aux comédiens en leur demandant de créer des parcours libres autour de leurs figures, de les nourrir de propositions personnelles et d’improvisations. Comme l’une des questions centrales du texte est celle de la solitude, nous sommes partis de ce thème puis nous avons construit des passerelles, des interactions entre des parcours individuels et des moments collectifs. Parallèlement, nous nous sommes attachés à construire une structure plus globale, à agencer ces «moments » en ce que nous avons appelé des «blocs ». Entre chaque bloc, nous continuions d’intervertir, de faire circuler les scènes. Ainsi, partant d’un état fragmentaire, incomplet du texte, il s’agissait d’observer comment le spectacle pouvait se régénérer au plateau. La part intime que met chaque comédien dans sa figure varie au cours du spectacle. Ainsi, dans la scène du braquage d’identité, prenant appui sur une phrase de Richter − « je veux entendre des histoires / de gens / je veux enfin les voir en live» −, les comédiens se mettent à improviser sous la menace d’un revolver que Maud mime avec ses doigts. Elle leur pose des questions et ils doivent répondre en livrant des informations personnelles. Cette scène brouille la frontière entre le comédien et sa figure.
Que gardez-vous de la rencontre avec ce texte et, au-delà, avec l’écriture de Richter ? Envisagez-vous de la travailler à nouveau ?
Maëlle Dequiedt : L’intérêt d’une écriture au présent, qui a le courage de se frotter au réel et qui est marquée par une dynamique de construction/ déconstruction. Cela nous a permis de développer sur scène une grammaire personnelle. C’est l’une des forces de ce projet. Pour autant, je ne pense pas y revenir dans l’immédiat. J’ai besoin de développer une écriture de plateau en me confrontant à d’autres auteurs contemporains.
Entretien téléphonique réalisé par BÉRÉNICE HAMIDI-KIM Lyon et Lille, 12 juin 2018